Histoire de la Montagne-refuge, François Boulet, Document XXII de la SHM, Les Editions du Roure, Yssingeaux, 2008, 416 pages, 38 €.
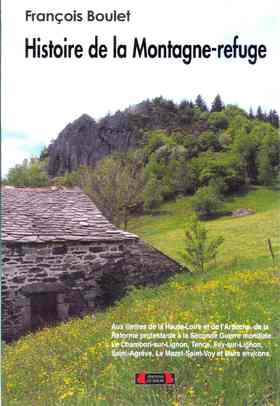
Cet ouvrage prolonge une série de conférences prononcées par l'auteur sur le même thème en 2006/2007 à l'invitation de la Société d'Histoire de la Montagne. A l'est du Velay et au nord-ouest du Vivarais, la « Montagne », pays « entre-deux », contrasté, zone de rupture entre deux mondes mais aussi bout du monde, cultive ses particularismes. Cet îlot a pu être considéré comme une « petite Suisse ». Mais son originalité est aussi humaine, culturelle et le fait religieux s'y impose.
Le récit se structure très clairement en six parties chronologiques bien identifiées : la Montagne des origines au Désert des Huguenots (1787), la Montagne des Protestants et des Catholiques (1787-1940), la Montagne- refuge des judéo-protestants (1940-1943), la Montagne-maquis (1940-1943) et la Montagne de 1945 à nos jours. D'abondantes annexes, avec entre autres des listes de Juifs français et étrangers réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale, des listes des élèves de l'Ecole Nouvelle Cévenole de 1939 à 1945, une chronologie minutieuse des événements des débuts de la Réforme à nos jours ainsi qu'une bibliographie exhaustive de plus de 700 entrées complètent fort judicieusement cet ouvrage. François Boulet nous a donné ici une synthèse qui s'impose déjà comme le livre de référence désormais indispensable aussi bien pour l'honnête homme cultivé et l'amateur d'histoire que pour le chercheur.
La Deuxième Guerre mondiale, des terres de refuge aux musées, sous la direction de Patrick Cabanel et de Laurent Gervereau, Sivom Vivarais-Lignon, Saint-Agrève, 2003, 376 pages, 30 €.
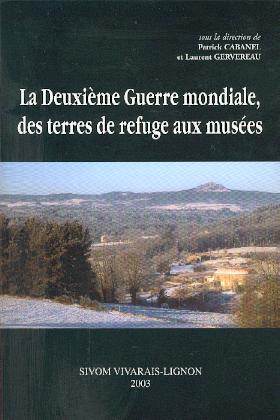
En décembre 2000, des représentants de l’Etat et de la commune du Chambon-sur-Lignon signent une convention qui prévoyait la création d’un musée de la résistance civile au Chambon. Ce projet partait du constat que si, sur le plan muséographique, les thèmes de la violence nazie et des résistances armées avaient été très largement exploités et bien mis en valeur, il n’en allait pas de même de ceux du refuge, de l’entraide et des réseaux de sauvegarde des juifs et de toutes les autres victimes de la répression, qui trop longtemps perçus sous l’angle d’une résistance « passive » s’étaient trouvés dévalorisés en considération de l’intérêt par trop exclusif apporté à la seule résistance armée. Or les avancées récentes de la recherche, avec entre autres les travaux de Jacques Semelin, avaient considérablement revalorisé l’importance d’une résistance qui n’était plus désormais perçu comme « passive », mais comme civile. Le choix du site du Chambon-sur-Lignon, au cœur du Plateau Vivarais Lignon, aux confins des départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche, dont le rôle dans l’accueil des réfugiés, des réfractaires du STO et des juifs pendant la dernière guerre est désormais bien connu[1], apparaissait de ce fait tout à fait légitime.
Dans la perspective de la création de ce musée, que l’on pensait alors prochaine, le syndicat intercommunal du Plateau Vivarais-Lignon, devenu le porteur du projet, et la Société d’histoire de la montagne (SHM), société savante locale, coorganisèrent avec l’Association internationale des musées d’histoire, présidée par Laurent Gervereau, deux journées d’études en juillet 2002, dont les actes furent édités par le Sivom en 2003. La journée du 5 juillet, sous la direction de Laurent Gervereau, aborda des questions essentielles relatives à la muséographie de la guerre, en considération de l’abondance des sites et des objets, à l’éveil de l’intérêt des jeunes publics et à la relation de la mémoire et de l’histoire, en réfléchissant à partir des exemples fournis, entre autres, par le Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg, l’Imperium War Museum, la Maison d’Izieu, le centre d’histoire et de mémoire de La Coupole, près de Saint-Omer, le cas de la Topographie des Terrors à Berlin, ou le centre européen du résistant déporté, encore en gestation à cette date, sur le site du camp de Natzweiler Struthof en Alsace.
La journée du 6 juillet, sous la responsabilité de Patrick Cabanel, fut consacrée à un bilan scientifique interdisciplinaire des connaissances acquises sur les grands traits de la période et sur l’histoire du Plateau, avec les contributions, entre autres, de Jacques Semelin, qui traita de la Résistance civile en Europe, de Bernard Comte et de Pierre Bolle. Dans sa propre contribution, Patrick Cabanel souligna avec force que le facteur essentiel du succès du refuge sur le Plateau, par delà les données de la topographie, de l’économie rurale ou encore de l’infrastructure touristique, était bien à rechercher dans le facteur religieux, dans l’existence d’un isolat protestant, avec ses traductions culturelles et politiques.
[1] Le Plateau Vivarais Lignon. Accueil et Résistance 1939-1944, sous la direction de Pierre Bolle, Société d’Histoire de la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon, 1992.
Les Résistances sur le Plateau Vivarais-Lignon, 1938-1945. Témoins, témoignages et lieux de mémoire. Les oubliés de l’Histoire parlent, Documents de la Société d’Histoire de la Montagne n°XXI, Editions du Roure, Communac-Polignac, 2005, 208 pages, 22 €.

En complément des actes des journées d’études de 2002, la SHM vient de faire paraître un autre ouvrage collectif qui prend plus particulièrement en considération le phénomène des conflits de mémoire sur le Plateau. L’histoire du Chambon-sur-Lignon est en effet essentiellement connue, dans le grand public tout au moins, par l’intermédiaire d’une mémoire non-violente et en partie légendaire, qui prend appui sur l’Autobiographie à ce jour inédite du pasteur André Trocmé et sur l’ouvrage de l’universitaire américain Philip Hallie[1], spécialisé dans l’étude des problèmes d’éthique, qui s’est en fait largement inspiré de l’Autobiographie. Or cette mémoire non-violente n’est pas exempte d’intentions polémiques et blessantes à l’égard d’authentiques résistants qui périrent au combat, comme Raoul Debiève ou encore le docteur Roger Le Forestier[2], arrêté au Puy-en-Velay le 4 août 1944 et assassiné à Saint-Genis-Laval le 20 août 1944.
Sur le Plateau Vivarais Lignon, les mémoires de la Deuxième Guerre mondiale en confrontation, la mémoire non-violente et la mémoire de la résistance armée, fournissent, malheureusement, un exemple de cette concurrence des victimes qu’a analysée par ailleurs le sociologue Jean-Michel Chaumont. La SHM a donc voulu, dans un recueil de témoignages où se mêlent les paroles ou les évocations de réfugiés, de républicains espagnols, d’enfants cachés juifs, d’autochtones protestants, de réfractaires et de maquisards, donner la parole aux « oubliés de l’histoire », consciente aussi de ce que l‘histoire scientifique ne peut s’écrire qu’en dépassant les confrontations de mémoire. Comme le rappelle d’ailleurs Paul Ricoeur, qui enseigna au lendemain de la guerre pendant trois ans au collège cévenol au Chambon, et qui accepta, en juillet 2002, la présidence d’honneur des journées d’études, le travail de la mémoire doit permettre de combattre l’oubli, et c’est en ce sens qu’il rejoint l’œuvre muséographique, mais il doit aussi préserver du danger de la répétition, du ressassement pathologique des humiliations comme des actions héroïques, pour aider en fait à vivre le présent et à se tourner vers l’avenir.
Plus que jamais doit donc primer le devoir d’histoire et c’est en ce sens qu’il faut espérer que parvienne un jour enfin à aboutissement le projet de musée de la résistance civile, dans la configuration scientifique, laïque et républicaine qui fut la sienne au début des années 2000, et qui n’est au demeurant nullement exclusive de la prise en considération du fait religieux.
[1] Le sang des innocents. Le Chambon-sur-Lignon village sauveur, Philip Hallie, Stock, Paris, 1980.
[2] Le Forestier fut le modèle dont s’inspira Albert Camus pour camper le personnage du docteur Rieux, héros de La Peste, roman emblématique de la lutte contre le fascisme écrit en partie lors de ses séjours à Panelier, hameau du Mazet-Saint-Voy, pendant la guerre.
L’état d’esprit en Haute-Loire 1940-1944 : des refuges aux maquis, F. Boulay, Le Puy-en-Velay, Cahiers de la Haute-Loire, Société d’Histoire de la Montagne, 2003, 498 p., 40 €.

Entre 1940 et 1944, de la Défaite à la Libération, face aux Allemands vainqueurs, la Haute-Loire se situe comme un des départements privilégiés de refuges puis de maquis. Il est à la croisée de l’histoire exceptionnelle de l’arrière-pays, montagnard et français, pendant les années 1940-1944.
Il nous offre un exemple des réactions de la France rurale, « moyenne », prétendue « profonde » ou « ordinaire », des « gens de la terre »: un état d’esprit à la fois particulariste et patriotique, passionnant, que l’auteur vous propose de découvrir.
La Haute-Loire possède l’originalité de rassembler différents refuges : réfugiés de l’Exode, réfugiés alimentaires, Etrangers et Juifs avec notamment la Montagne-refuge judéo-protestante à l’Est du département, réfractaires de la Relève puis du Service du Travail obligatoire (S.T.O.). De surcroît, ce département devient en 1943-1944 un pays des « gens du maquis », d’abord groupes disséminés et foisonnants jusqu’au maquis-mobilisateur ou réduit de la Haute-Auvergne, avec le Mont-Mouchet.
Afin de mieux comprendre ce rôle de refuge puis de maquis, l’auteur prône une histoire micro-géographique et psychologique, à l’échelle du tempérament du « pays » et du bourg, située entre la commune, le canton et l’arrondissement. C’est avec cet ancrage local, que le témoignage et l’archive, de la préfecture, de la gendarmerie, ou de la police, peuvent éclairer l’histoire précise de ces « Hautes-Terres », souvent surprenantes au cours de ces années dramatiques.
Deux fortes conclusions se dégagent. D’une part, l’auteur insiste sur la différence d’état d’esprit entre une montagne-refuge et une montagne-maquis. Entre accueillir un Juif ou un réfractaire du S.T.O. dans sa ferme et côtoyer quotidiennement les « gens du maquis », le danger n’est pas de même nature. D’autre part, la Haute-Loire manifeste un état d’esprit « atterré » en 1940 et en 1944. La réalité matérielle, obsédante, nourrit toutes les passivités, les jalousies, les haines. Pourtant, par sa spiritualité et son bon sens populaire, elle trouve des occasions d’aider autrui, avant soi-même, et de prouver son idéal de liberté avec fierté et réussite.
Né en 1965, l'auteur est professeur agrégé d’histoire au Lycée Jean-Baptiste Poquelin de Saint-Germain-en-Laye. A travers colloques et publications, dont sa thèse de doctorat soutenue en 1997 et éditée en 1999, intitulée Les montagnes françaises 1940-1944 : des montagnes-refuges aux montagnes-maquis (Lille, Thèse à la carte, A.N.R.T., 722 pages), l’auteur s’est passionné pour l’histoire des montagnes françaises entre 1940 et 1944, avec, pour centre géographique privilégié, le département de la Haute-Loire et notamment la « Montagne » protestante. Il s’est spécialisé dans l’étude de l’état d’esprit des « gens de la terre » face aux refuges puis aux « gens du maquis ». Il continue son enquête historique à travers une étude personnalisée des préfets et des gendarmes sous l’Occupation (Cahiers de la Haute-Loire, 2004-2005).
Traces légendaires, mémoires et construction identitaire. Etude socio-historique d’une « presqu’île » cévenole en Haute-Loire, S. Bernard, diffusée par ANRT Diffusion, Lille, 2004, 464 pages, 45 €.

Thèse dirigée par Annie Guedez, soutenue le 6 février 2004, à Poitiers. Le jury était composé des professeurs d’histoire contemporaine Patrick Cabanel (Toulouse-Le Mirail), et Michel Fafréguet (Strasbourg-Robert Schuman), des professeurs de sociologie A. Guedez (Poitiers), Gilles Ferreol (Poitiers) (président) et Alain Pessin (Grenoble-Pierre Mendés France). En février 2005, Serge Bernard a été qualifié par le Conseil national des universités aux fonctions de maître de conférences en sociologie.
La première partie de la recherche traite de la construction de la mémoire légendaire du village de la montagne protestante du Chambon-sur-Lignon autour de l’épisode essentiel de l’accueil et du sauvetage exemplaire des enfants juifs (1940-1944), épisode dit de résistance civile (ou spirituelle), sans occulter toutefois les enjeux de mémoires croisées et fortes rivalités subséquentes.
La seconde partie, marquage identitaire et construction territoriale, étudie la genèse et la structure du territoire, spécialement fécond en en dissidences et mouvements religieux, en montrant comment l’économique est « sublimé » en culturel, ainsi le tourisme et les accueils y sont représentés comme une tradition et une éthique communautaire. L’interaction entre construction territoriale et identité sociale est montrée à travers une démarche de type anthropologique qui privilégie sur une longue durée l’observation de la réification des traces pour comprendre : les usages sociaux contemporains de l’histoire, la recomposition des traditions et les mutations territoriales dans les domaines démographiques, économiques et politiques.
Selon le rapporteur, cette thèse est un « exemple réussi de sociologie historique d’un territoire » (…), « histoire réelle, légendarisée aujourd’hui à travers un jeu complexe d’intérêts symboliques et économiques » (…), une « étude qui dépasse de loin l’histoire locale et qui démontre la dialectique entre légendarisation et identités territoriales » et qu’il convient donc de « lire en boucle » selon l’expression même de son auteur.
La Montagne protestante. Pratiques chrétiennes sociales dans la région du Mazet-Saint-Voy 1920-1940, C. Maillebouis, Préface de P. Cabanel, Editions Olivétan, Lyon, 2005, 204 p., 25 €. Publié avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et le Centre National du Livre. En vente auprès de l'auteur : C. Maillebouis, 43520 Le Mazet-Saint-Voy.

« La vérité est un cristal aux multiples facettes. Plus le nombre de réflexions grandit, et plus nous tendons vers la perfection sphérique » écrit l’auteur dans son avertissement. L'auteur est un néo-rural établi dans la région du Mazet-Saint-Voy en 1979, ingénieur de formation mais également amateur d’histoire locale, qui ne fait pas mystère de son athéisme mais qui se targue aussi de relations d’amitié et de confiance avec ses « voisins croyants » de toutes les Eglises locales.
De cette intégration réussie, plusieurs travaux d’érudition locale témoignaient déjà, avant la publication de ce livre, dont l’ampleur dépasse en fait la simple étude érudite d’histoire locale, comme le souligne Patrick Cabanel dans sa préface. Recherchant en fait à mieux connaître les raisons de l’accueil des juifs dans la Montagne pendant la Seconde Guerre mondiale, Christian Maillebouis a été amené à repérer les « pratiques chrétiennes sociales » dans l’entre-deux-guerres, à l’intersection des grandes impulsions nationales et des initiatives locales, des grandes idées portées par les intellectuels et des réalisations des acteurs locaux, montrant bien ainsi qu’une région n’est pas un simple terrain d’application, mais plutôt de rencontre.
Au lendemain des traumatismes de la Première Guerre mondiale, la région du Mazet-Saint-Voy a donc été le lieu d’expérimentations originales, à la convergence de discours militants, de solidarités campagnardes et de pensées chrétiennes issues du Réveil. Les œuvres sociales protestantes, le congrès du christianisme social au Chambon-sur-Lignon, en septembre 1933, l’œuvre des Enfants à la Montagne, la coopérative laitière du Mazet-Saint-Voy, les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, la politique d’éducation et de protection de l’enfance, mais aussi l’action pionnière des Chevaliers de la Paix en faveur du pacifisme et du rapprochement franco-allemand en apportent, entre autres, la preuve.
Michel Fabréguet